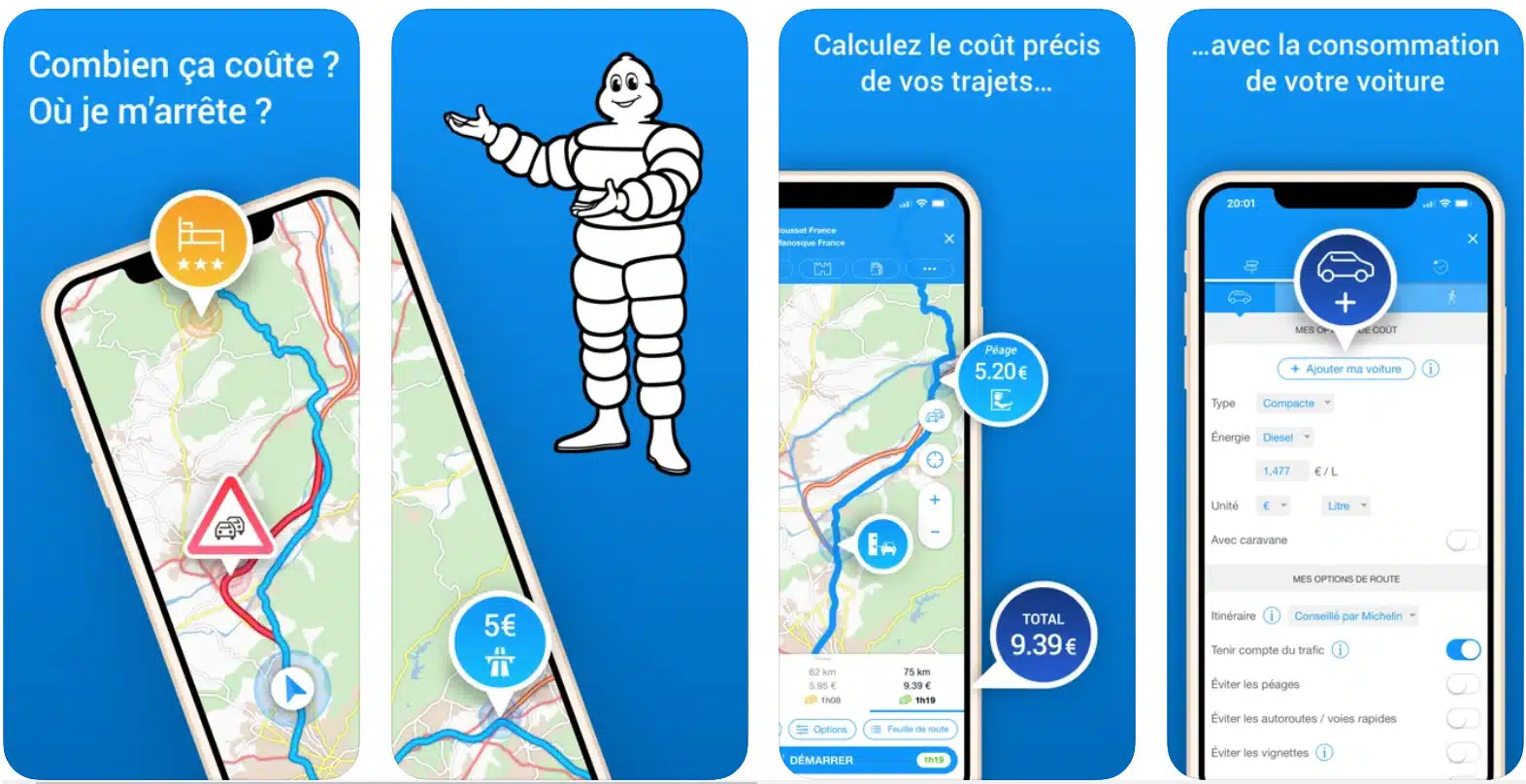200 000 euros contre moins de 20 000 : le gouffre séparant les patrimoines médians des 60-69 ans et des moins de 30 ans en France ne se comble pas, il s’élargit. L’Insee le dit sans détour, chiffres à l’appui. D’un côté, une génération qui a capitalisé sur la stabilité et la montée de l’immobilier ; de l’autre, une jeunesse qui avance sur un terrain miné, entre loyers étouffants et salaires qui stagnent. Malgré un niveau de vie globalement en hausse, l’héritage pèse lourd et accentue ce découpage, tout comme la composition familiale et le lieu de résidence. À Paris, le rêve de propriété semble plus lointain qu’en province, et les familles monoparentales restent souvent sur la touche.
Patrimoine et âge : un panorama des écarts générationnels
En France, la ligne de partage du patrimoine saute aux yeux dès qu’on observe les âges. L’Insee le confirme : entre 60 et 69 ans, la médiane dépasse 200 000 euros. Avant 30 ans, la barre des 20 000 paraît un sommet hors d’atteinte, et ce n’est pas près de changer. L’immobilier, inaccessible pour beaucoup, concentre l’essentiel du capital, tandis que l’héritage vient renforcer les positions déjà acquises.
Voici comment se répartit le patrimoine selon les générations :
- Les 60-69 ans : au sommet, ils ont accumulé logements et placements, bénéficiant à leur époque d’un marché bien plus abordable.
- Les moins de 30 ans : souvent locataires, ils affrontent la précarité professionnelle et voient l’accès à la propriété s’éloigner.
Le niveau de vie dépend aussi du foyer. Un couple sans enfant dispose d’un patrimoine bien supérieur à celui d’une famille monoparentale, et l’écart se creuse encore selon la région. En province, l’accès au logement reste plus simple qu’en région parisienne, où la tension immobilière aggrave la fracture.
On parle beaucoup de moyenne, mais elle masque la réalité : le niveau de vie médian s’établit autour de 1 900 euros par mois et par unité de consommation. Pourtant, dès l’enfance, les écarts se dessinent. Les enfants des familles les plus aisées héritent non seulement d’un capital, mais aussi d’un accès précoce aux ressources. D’autres avancent à petits pas, freinés par des revenus qui progressent peu et la difficulté à se constituer un patrimoine. L’âge influe, mais le contexte verrouille souvent la mobilité.
Qui détient le plus de richesse en France aujourd’hui ?
La concentration de la richesse en France atteint des niveaux rarement égalés. L’Insee le mesure : le centile le plus riche détient à lui seul près de 16 % du patrimoine brut. Pour figurer parmi les 10 % les plus fortunés, il faut dépasser 716 300 euros de patrimoine net par adulte. Ces 10 % réunissent près de la moitié du patrimoine total du pays.
Pour saisir l’ampleur de l’écart, l’Observatoire des inégalités fixe le seuil de richesse à 3 860 euros par mois pour une personne seule, soit le double du niveau de vie médian. Ce niveau reste hors de portée pour la grande majorité. À l’autre extrémité, la moitié des foyers français ne dépassent pas 177 200 euros de patrimoine.
Quelques exemples pour illustrer cette polarisation :
- Bernard Arnault, patron de LVMH, fait figure d’exception planétaire avec plus de 200 milliards d’euros d’actifs. Sa fortune le classe régulièrement parmi les plus riches du monde.
- Le seuil de pauvreté stagne à 1 120 euros par mois et par unité de consommation, signe d’une fracture qui ne se referme pas.
Les disparités ne s’expliquent pas seulement par les salaires. La transmission du patrimoine, la fiscalité et l’accès très inégal à l’immobilier pèsent tout autant. Ainsi, l’héritage et l’accumulation sur plusieurs générations renforcent des positions déjà établies, bien au-delà de la seule rémunération du travail.
Comprendre l’évolution du patrimoine au fil de la vie
Le patrimoine ne s’accumule pas d’un seul coup. Les chiffres de l’Insee dessinent une progression marquée par les grandes étapes de l’existence : études, premier emploi, achat d’un bien, transmission familiale. Avant 30 ans, le patrimoine net moyen culmine à peine au-dessus de 15 000 euros, souvent sous forme d’économies ou d’une voiture. Rares sont ceux qui accèdent à la propriété si tôt.
Avec l’âge, la situation change. Passé 40 ans, le patrimoine grimpe, porté par l’achat immobilier et l’épargne. Entre 40 et 59 ans, la moyenne atteint 236 200 euros. Chaque décennie accentue l’écart : les plus de 70 ans culminent au-delà de 315 000 euros, cumul de toute une vie d’épargne, d’héritages et parfois de plus-values sur la pierre.
Le niveau de revenu influe directement sur la capacité à épargner et à investir. Plus il est élevé, plus la part de l’immobilier et des placements financiers augmente. Pourtant, cette dynamique n’efface pas la réalité : un ménage sur deux, tous âges confondus, ne possède pas plus de 177 200 euros. Pour les jeunes générations, la flambée des prix et la précarité de l’emploi compliquent encore la constitution d’un patrimoine.
Inégalités de richesse entre générations : quelles tendances et enjeux ?
Les écarts de richesse entre générations en France n’ont jamais été aussi prononcés. L’Insee et l’Observatoire des inégalités dressent le même constat : les plus de 50 ans concentrent près de la moitié du patrimoine total, tandis que les jeunes adultes peinent à atteindre les 20 000 euros d’actifs. L’explosion des prix de l’immobilier et la stagnation des salaires d’entrée ne font qu’aggraver cette fracture.
Le niveau de vie moyen des moins de 30 ans reste aujourd’hui inférieur à celui d’il y a vingt ans. Si les prestations sociales limitent en partie l’écart, la mobilité sociale ralentit. Le seuil de pauvreté touche davantage les jeunes, alors que les plus âgés bénéficient à la fois d’un capital accumulé et d’une meilleure couverture sociale. L’écart ne se limite plus aux actifs détenus : il concerne aussi l’accès à la propriété, les possibilités de consommation et la trajectoire des revenus.
Pour mieux appréhender ces disparités, voici quelques faits saillants :
- Les 10 % des ménages les plus riches concentrent près de la moitié du patrimoine national.
- Un tiers des moins de 40 ans ne possède aucun bien immobilier.
- Les seniors, en plus d’un niveau de vie supérieur, dépensent souvent moins, ce qui accroît encore leur capacité à épargner.
La question n’est plus seulement d’observer ces différences, mais de s’interroger sur l’équilibre à venir. Accéder à la propriété ou se constituer un capital devient un défi pour les générations suivantes. Les débats sur la fiscalité des transmissions et la revalorisation du travail reviennent inévitablement sur le devant de la scène. Face à cette réalité, la société devra choisir de quelle manière elle souhaite resserrer les rangs, ou accepter que le fossé se creuse encore.